7 armes les plus controversées dans les conflits modernes

La Cour internationale de justice saisie d’une plainte contre un pays accusé d’avoir utilisé des armes incendiaires dans une zone habitée par des civils : voilà un type d’affaire peu médiatisée, mais qui n’est pourtant pas un cas isolé. Ces dernières années, les conflits armés se sont accompagnés d’une inquiétante utilisation d’armes jugées inhumaines, dangereuses, voire interdites par le droit international. De plus en plus de voix s’élèvent pour dénoncer ces outils de guerre qui détruisent bien au-delà des cibles militaires.
Certaines de ces armes de plus en plus performantes et destructrices remettent vraiment en cause les limites morales de la guerre. Peut-on vraiment parler de « progrès » lorsqu’un drone peut frapper sans pilote ou qu’un explosif continue de tuer des années après la fin des combats ? Certaines sont connues, d’autres moins, mais toutes ont un point commun : leur usage fait débat, et parfois, scandalise. Les civils, de plus en plus touchés, sont souvent les premières victimes de ces technologies modernes.
Cet article met en lumière 7 armes parmi les plus controversées aujourd’hui, celles qui suscitent la peur, la colère ou le doute, même au sein des armées qui les emploient. Malgré les protestations, elles continuent quand même à être utilisées dans de nombreux conflits à travers le monde.
| 1 | Mines antipersonnel : Une arme bannie par le droit international, mais toujours utilisée dans certains conflits |

Les mines antipersonnel sont des explosifs dissimulés sous terre, dont l’objectif est d’empêcher l’ennemi de progresser sur un terrain donné. Le fait est qu’une fois posées, ces mines ne font pas la différence entre un soldat et un civil, ce qui les rend particulièrement dangereuses, même longtemps après la fin d’un conflit.
En 1997, le Traité d’Ottawa a été adopté pour en interdire l’utilisation, la production, le stockage et le transfert. À ce jour, plus de 160 pays ont signé cet accord pour montrer leur une volonté de les éliminer. Toutefois, certaines puissances militaires comme la Russie, les États-Unis ou la Chine ne l’ont pas ratifié.
Bien sûr, les conséquences sont désastreuses. Selon l’Observatoire des mines, plus de 4 000 personnes ont été tuées ou blessées par ces engins, dont près de la moitié étaient des enfants en 2022. Les mines rendent aussi des territoires entiers inhabitables pendant des années. Elles empêchent la reconstruction, freinent l’agriculture et obligent des milliers de familles à vivre dans la peur.
| 2 | Drones de surveillance et de frappe : Des attaques ciblées par drones suscitent des débats éthiques sur la souveraineté et la responsabilité |

Les drones militaires, également connus sous l’appellation « UAV » (Unmanned Aerial Vehicles), sont aujourd’hui devenus des outils d’armement privilégiés. Utilisés à la fois pour surveiller des zones à risque et lancer des frappes aériennes, ils permettent aux armées d’agir à distance sans exposer leurs soldats.
Les États-Unis ont déjà utilisé ces drones dans leurs opérations antiterroristes au Yémen, au Pakistan ou encore en Somalie. Ces frappes sont souvent décrites comme “chirurgicales”, c’est-à-dire précises et ciblées. Pourtant, des organisations comme Amnesty International et Human Rights Watch ont documenté de nombreux cas où des civils ont été tués par faute d’identification correcte des cibles. En 2021, une frappe américaine à Kaboul a tué 10 civils, dont 7 enfants, à la suite d’une erreur de renseignement.
Lorsqu’une erreur est commise, il est difficile d’assigner la faute. Qui doit rendre des comptes ? Le pilote à distance ? Le commandement militaire ? Des questions sans réponses qui alimentent les polémiques et rendent urgente une régulation claire de l’usage de ces armes de guerre certes, plus discrète, mais tout aussi meurtrière.
| 3 | Gaz toxiques et armes chimiques : L'utilisation de produits chimiques dans les conflits modernes, comme en Syrie |

Depuis la Convention de 1993 ratifiée par 193 pays, l’utilisation d’armes chimiques est interdite par le droit international. Le fait est qu’elles n’ont pas encore totalement disparu. Preuve en est lors du récent conflit en Syrie où plusieurs attaques chimiques ont été confirmées par l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC). Il ne faut pas non plus oublier qu’en 2013, à Ghouta, une attaque au gaz sarin a causé la mort de plus de 1 400 personnes, dont de nombreux enfants.
Ce type de gaz, souvent invisibles et inodores, provoquent des suffocations, des brûlures internes et des morts atroces. Leur emploi vise parfois à semer la terreur plus qu’à vaincre militairement. Ces armes chimiques, une fois libérées, peuvent contaminer une zone entière et rendre un environnement inhabitable.
Hormis les pertes humaines et impacts environnementaux, ces armes font office d’outils de violation des traités internationaux et provoquent une indignation à l’échelle mondiale. Dans bien des cas, les responsables échappent aux sanctions ou nient toute implication, ce qui rend la justice difficile à appliquer.
| 4 | Armes à énergie dirigée : Leur utilisation potentielle dans les guerres modernes soulève des inquiétudes sur leur impact et leur régulation |

Les armes à énergie dirigée utilisent des rayonnements pour neutraliser une cible. Contrairement aux armes classiques, elles sont dénuées de projectiles, mais concentrent une source d’énergie pour désactiver des équipements électroniques, aveugler des capteurs ou même causer des brûlures à distance. On distingue 4 armes à énergie :
1) Les armes à laser qui utilisent un faisceau laser concentré pour chauffer et endommager la cible (missiles, drones, optiques, etc.).
2) Les armes à micro-ondes à haute puissance (HPM) qui utilisent des micro-ondes pour griller les circuits électroniques ou perturber les systèmes de communication.
3) Les armes à ondes radio ou électromagnétiques (EMP) qui produisent une impulsion électromagnétique qui peut désactiver des appareils électroniques sur une large zone.
4) Les armes acoustiques (ultrasons/infrasons) qui utilisent des ondes sonores puissantes (infrasoniques ou ultrasoniques) pour désorienter, blesser ou disperser des personnes.
Ces technologies, encore en cours de développement, intéressent particulièrement les armées américaines, chinoises et russes. Certaines ont déjà été testées sur des drones ou des satellites. Leur principal danger réside dans leur discrétion : elles ne laissent souvent aucune trace visible, ce qui complique la preuve d’une attaque et la réponse juridique.
Pour l’instant, il n’existe aucun cadre international strict concernant leur utilisation. Cela inquiète les chercheurs et les défenseurs des droits humains qui craignent que ces armes ne soient utilisées sans contrôle, notamment contre des civils ou dans des situations où leur impact réel est encore mal connu.
| 5 | Armes biologiques : Bien que rares, leur développement soulève des préoccupations majeures concernant la biosécurité |

Les armes biologiques utilisent des agents pathogènes pour provoquer des maladies mortelles chez les Hommes et les animaux. Bien que leur utilisation soit interdite par la Convention sur les armes biologiques de 1972 ratifiée par la quasi-totalité des États membres de l’ONU, leur développement n’a jamais totalement disparu.
L’un des aspects les plus inquiétants de ces armes est leur capacité à se propager de façon incontrôlable. Une attaque ciblée peut rapidement devenir une épidémie et même affecter les populations de l’attaquant. Le principal danger ne vient donc pas seulement de leur usage, mais de leur potentiel. Une attaque bien menée pourrait avoir des conséquences comparables à celles d’une arme nucléaire, mais avec des moyens bien plus simples et discrets.
Même si peu de cas d’utilisation avérée ont été confirmés, des laboratoires militaires continuent de mener des recherches à visée défensive pour créer des vaccins ou des antidotes. Le fait est qu’il n’y a quasiment pas de limite entre recherche défensive et offensive, ce qui fait que les risques de fuites ou d’usage détourné existent.
| 6 | Bombes à fragmentation : Leur capacité à affecter les civils en raison de leur conception en fait une arme controversée |

Les bombes à fragmentation ou « sous-munitions » sont des armes qui se divisent en dizaines, voire en centaines de petites charges explosives en plein vol. Elles couvrent une large zone et sont en mesure de neutraliser plusieurs cibles en une seule frappe. Leur usage est souvent justifié par des objectifs militaires comme détruire des colonnes de véhicules ou empêcher l’avancée ennemie.
Cependant, le coût humain est très lourd. Le fait est qu’une partie de ces armes n’explose pas à l’impact comme les mines antipersonnel et reste dangereuse pendant des années. Ainsi, elles deviennent des pièges mortels pour les civils, dont les enfants qui peuvent les confondre avec des objets sans danger. Il y a aussi cette incapacité à faire la distinction entre civils et militaires, combinée à leur persistance dans le temps, qui rend ces armes particulièrement controversées. Selon l’ONG Cluster Munition Coalition, 97 % des victimes de ces bombes entre 2010 et 2020 étaient des civils.
En 2008, la Convention sur les armes à sous-munitions a été adoptée par plus de 120 pays pour interdire leur usage. Mais, encore une fois, plusieurs grandes puissances comme la Russie, les États-Unis ou la Chine n’y ont pas adhéré. En 2023, les forces russes ont été accusées d’avoir utilisé des bombes à fragmentation en Ukraine, ce qui a relancé le débat sur leur interdiction complète.
| 7 | Armes autonomes : Les robots et systèmes d'armement autonomes posent des questions sur la responsabilité et la moralité de la guerre |

Les armes autonomes sont des systèmes capables de sélectionner et d’attaquer une cible sans intervention humaine directe. Ils sont connus pour être des “robots tueurs”. Leur développement est encore en cours, mais des prototypes existent déjà. Cette évolution soulève des questions majeures sur la manière dont les guerres seront menées à l’avenir.
En 2020, un rapport de l’ONU a indiqué qu’un drone autonome aurait attaqué des combattants en Libye sans ordre humain direct. Il s’agit là d’une première dans l’histoire. Cela signifierait qu’un robot a pris la décision de tuer par lui-même, une situation inquiète de nombreux experts.
De même que les drones de surveillance et de frappe, il est difficile de définir formellement le responsable. Si une machine commet une erreur ou tue un civil, qui doit en répondre ? Le concepteur, le militaire qui a activé le système ou le pays qui l’utilise ? À ce jour, aucun cadre juridique clair ne répond à ces interrogations.
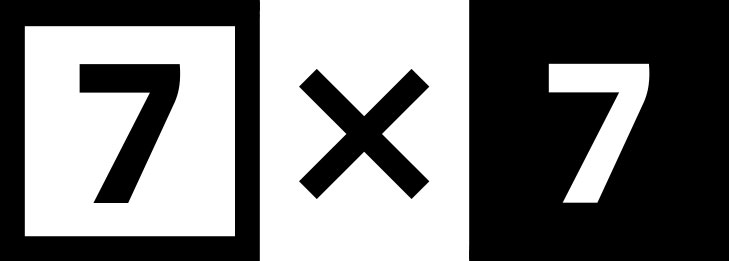
 Anticiper
Anticiper













Commentaires