Les 7 grandes alliances militaires mondiales à suivre en 2025

Face aux menaces sécuritaires, terroristes, cybernétiques et nucléaires qui façonnent le paysage géopolitique mondial actuel, les États n’agissent plus seuls. Ils s’organisent en alliances militaires en mesure de rassembler les stratégies de défense, les ressources et les technologies. Ces rapprochements souvent bâtis sur des décennies de coopération diplomatique représentent aujourd’hui de véritables piliers de stabilité sur la scène internationale.
Ces grandes alliances militaires ne se contentent plus, en effet, des accords symboliques, mais sont devenues de véritables instruments de projection de puissance, d’influence géopolitique et de dissuasion stratégique. L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), l’une d’entre elles, a par exemple renforcé sa cohésion face à la guerre en Ukraine tandis que d’autres comme l’Organisation du traité de sécurité collective (CSTO) peinent à faire face à leurs propres défis internes. À cela s’ajoutent des alliances émergentes comme en Asie et au Moyen-Orient qui rééquilibrent les rapports de force mondiaux.
Il est donc important de bien comprendre les dynamiques des principales alliances militaires pour mieux cerner les enjeux de sécurité collective pour les années à venir. Tour d’horizon alors sur les 7 grandes alliances militaires mondiales afin de saisir le sens des contours d’un monde où les alliances font la force.
| 1 | OTAN : L’alliance la plus influente, notamment face aux menaces russes et chinoises |

L’OTAN, fondée en 1949, reste aujourd’hui l’alliance militaire la plus influente au monde. Composée de 32 membres à ce jour, elle représente un pilier central de la sécurité transatlantique. Elle se base sur le principe de défense collective inscrit à l’article 5 du traité : « une attaque contre l’un de ses membres est considérée comme une attaque contre tous ». Cette règle a été invoquée pour la première fois après les attentats du 11 septembre 2001.
Depuis 2022, l’invasion russe de l’Ukraine a profondément ravivé le rôle stratégique de l’OTAN. Cette dernière s’est, en effet, mobilisée pour renforcer sa présence militaire en Pologne, aux pays baltes et en Roumanie et a fourni une aide massive à l’Ukraine bien que celle-ci ne soit pas membre de l’alliance. En parallèle, la montée en puissance militaire de la Chine inquiète plusieurs membres, dont les États-Unis qui encouragent l’OTAN à étendre sa vision stratégique vers le territoire indo-pacifique.
En 2025, l’OTAN se présente donc comme une réponse structurée face à deux puissances perçues comme concurrentes : la Russie et la Chine. Son budget dépasse largement celui de toute autre alliance militaire et les États-Unis y assurent une position dominante aussi bien sur le plan stratégique que technologique.
| 2 | Alliance Chine-Russie : Une collaboration stratégique face à l’Occident |

Contrairement à l’OTAN, l’alliance entre la Chine et la Russie n’est pas officiellement codifiée dans un traité militaire global, mais repose sur une collaboration stratégique de plus en plus solide et motivée par une opposition commune à l’ordre international dominé par les États-Unis et leurs alliés. Depuis l’intensification des tensions géopolitiques autour de l’Ukraine et de Taïwan, cette association a pris une tournure plus militaire et diplomatique.
Actuellement, les deux pays organisent régulièrement des exercices militaires conjoints en mer de Chine, en mer du Japon ou encore en Asie centrale. Ces manœuvres visent aussi bien à améliorer l’interopérabilité de leurs forces qu’à envoyer un message dissuasif aux puissances occidentales. La Chine bénéficie de l’expertise militaire russe, notamment en matière de systèmes de défense aérienne, tandis que Moscou s’appuie sur la puissance économique et technologique de Pékin pour contrebalancer son isolement croissant. Cette alliance est aussi renforcée dans le domaine de la cybersécurité, du renseignement et de la coopération industrielle militaire.
| 3 | Groupe Quad (Inde, Japon, Australie, États-Unis) : Une réponse stratégique au renforcement militaire de la Chine |
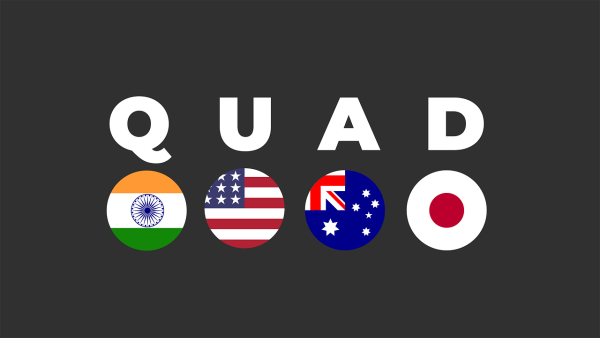
Le Groupe Quad (Quadrilateral Security Dialogue) est une alliance stratégique informelle dont l’objectif principal est de s’opposer à l’influence croissante de la Chine sur le territoire indo-pacifique. Malgré son statut illégitime, le Quad s’est fortement militarisé depuis 2020 à travers des coopérations renforcées, des exercices conjoints et un dialogue sécuritaire de plus en plus soutenu.
En 2025, la montée en puissance de la Chine, notamment en mer de Chine méridionale, autour de Taïwan et dans les routes maritimes stratégiques a renforcé sa cohésion. Les membres multiplient les manœuvres navales, les partages de renseignements et les projets de développement technologique en défense. Il faut savoir que l’Inde, historiquement non alignée, prend une posture plus affirmée, notamment face aux tensions frontalières avec la Chine dans l’Himalaya.
Au-delà de l’alliance militaire, le Quad s’inscrit aussi dans une vision plus large de « l’Indo-Pacifique libre et ouvert », surtout encouragée par les États-Unis. Il s’agit donc aussi d’un véritable projet géopolitique qui consiste à défendre la liberté de navigation, la stabilité régionale et le respect du droit international.
| 4 | CSTO (Organisation du traité de sécurité collective) : Une alliance militaire dirigée par la Russie pour la défense de l’Asie centrale |

Il s’agit d’une alliance militaire post-soviétique créée en 2002 sous la direction de la Russie. Elle regroupe six États : la Russie, le Belarus, l’Arménie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan. Son but est d’assurer la sécurité collective des États membres face aux menaces extérieures en Asie centrale qui est une région instable aux frontières de l’Afghanistan et de la Chine.
Ainsi, la CSTO fonctionne selon un principe similaire à celui de l’OTAN : une attaque contre un membre entraîne une réaction commune. Le fait est qu’en 2025, cette alliance montre des signes de fragilité. Si elle reste un instrument d’influence stratégique pour la Russie, les crises récentes ont fait ressortir ses limites. L’exemple le plus marquant est celui du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan qui, malgré les appels à l’aide d’Erevan, la CSTO n’est pas intervenue. Ceci a sérieusement remis en question la crédibilité de l’alliance.
Cependant, elle joue un rôle plus actif dans la lutte contre les groupes islamistes radicaux et les trafics transfrontaliers, dont au Tadjikistan et au Kirghizistan. Des bases russes permanentes sont implantées dans plusieurs États membres et des exercices militaires y sont régulièrement organisés.
| 5 | UE (Union européenne) : Des efforts de défense collective en réponse aux menaces externes |

L’Union européenne n’est pas une alliance militaire à proprement parler, mais développe depuis plusieurs années une capacité de défense commune. En 2025, ces efforts s’accélèrent face aux menaces géopolitiques croissantes, dont la Russie est à l’origine, aux cyberattaques et à l’instabilité aux frontières du continent.
Avec la guerre en Ukraine comme catalyseur, plusieurs pays européens ont, en effet, revu à la hausse leurs budgets militaires et soutiennent la montée en puissance de l’initiative européenne d’intervention, du Fonds européen de la défense et de projets de coopération structurée permanente (PESCO). L’objectif est de consolider l’autonomie de l’Europe sans pour autant sortir du cadre de l’OTAN, considéré comme le principal garant de la sécurité collective du continent.
Par ailleurs, des missions militaires européennes sont déployées dans des zones sensibles comme le Sahel ou les Balkans où l’UE agit comme soutien logistique, mais aussi comme force d’interposition. Le projet de créer une force de réaction rapide européenne de 5 000 soldats avance pas à pas et reflète une volonté politique réelle.
| 6 | Organisation de coopération de Shanghai (OCS) : Une alliance pour la sécurité régionale menée par la Chine et la Russie |

L’OCS, fondée en 2001, regroupe aujourd’hui la Chine, la Russie, l’Inde, le Pakistan, l’Iran ainsi que plusieurs pays d’Asie centrale. D’autres pays comme la Biélorussie et la Turquie en sont aussi membres à différent niveau d’association.
À ses débuts, son objectif principal repose sur la coopération anti-terroriste et le développement régional. L’OCS a alors progressivement élargi son spectre d’action à la sécurité, au commerce, à l’énergie et à la coordination militaire. Hormis les exercices conjoints régulièrement organisés, elle met aussi en place des mécanismes de partage de renseignement et agit comme plateforme de coordination géopolitique entre puissances non occidentales.
À l’inverse de l’OTAN, l’OCS ne s’engage pas sur la défense collective, mais sur un principe de coopération multilatérale flexible. Elle permet par exemple à la Chine et à la Russie de renforcer leur influence sur les anciennes républiques soviétiques et de concurrencer les institutions dominées par l’Occident. Ainsi, l’OCS se présente aujourd’hui comme un contre-modèle de gouvernance sécuritaire face aux institutions occidentales.
| 7 | Partenariats bilatéraux : Accord entre des nations comme Israël et les États-Unis ou l'Arabie Saoudite et la France pour des stratégies de défense |

Les partenariats bilatéraux militaires tiennent aussi une fonction clé dans l’équilibre sécuritaire mondial. Ces accords permettent à deux pays de coopérer étroitement en matière de défense, de renseignement ou de formation.
C’est par exemple le cas d’Israël et des États-Unis qui entretiennent une collaboration étroite et stratégique de longue date. Washington fournit une aide militaire annuelle d’environ 3,8 milliards de dollars à Tel-Aviv, incluant des systèmes d’armement avancés comme l’Iron Dome ou les avions F-35. Le cas de la France et de l’Arabie Saoudite est aussi un exemple marquant. Ils ont établi un partenariat autour de la modernisation des forces saoudiennes. Paris fournit des équipements (frégates, blindés, radars), assure la formation des officiers saoudiens et mène des exercices conjoints dans le Golfe. Toutes ces relations servent des intérêts économiques et géopolitiques tout en garantissant une influence stratégique dans une région instable.
Il ne faut pas oublier les autres partenariats bilatéraux clés associant certains pays : États-Unis–Japon, Turquie–Azerbaïdjan ou Russie–Syrie. Ces accords permettent aux puissances de projeter leur influence, de sécuriser des zones d’intérêt vital ou de contrôler des menaces spécifiques.
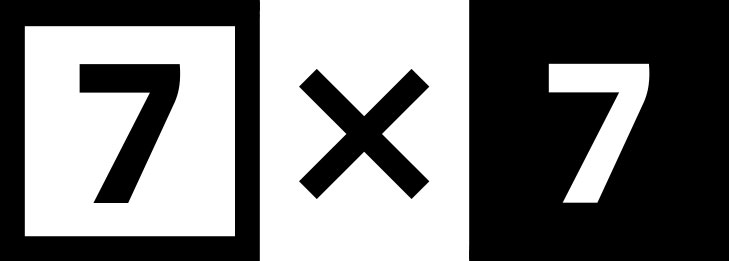
 Anticiper
Anticiper













Commentaires